Depuis 2012, j’ai participé à l’élaboration puis aux représentations d’un spectacle de variété intitulé Chant’Oulipo. Outre une bonne demi-douzaine de dates isolées (notamment en province), ce spectacle a fait l’objet de deux séries de représentations à Paris : au théâtre du Lucernaire à l’automne 2013, puis au théâtre Clavel début 2015 où nous avons enchaîné près de 25 représentations : une quantité tout à fait normale pour n’importe quel comédien, mais inédite pour le musicien-bricoleur que je suis.
Comme l’indique son titre, ce spectacle regroupe des textes d’auteurs actuels de l’Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo). À l’exception de quelques-uns, ces textes sont mis en musique (pour la plupart, par moi-même) sous forme de chansons ; j’ai d’ailleurs eu l’occasion (ici, ici et un peu ici) d’en publier quelques-unes, qui sont, comme tout ce que j’écris, disponibles sous licence Libre.
Ce dernier point soulève de multiples questions, auxquelles j’ai été tenté de répondre en me livrant, à la faveur de cette récente série de représentations, à ce que j’appelle une expérience sociale1 : proposer au public de se procurer, à la sortie de chaque représentation, une copie imprimée de certaines chansons du spectacle (sous forme de partition, éditée par mes soins, ré-arrangée et assortie d’explications).
Musique : Licence Art Libre
Textes : tous droits réservés.
Voici une présentation — fort peu scientifique — de cette initiative et de ses résultats, précédées de quelques remarques sur son contexte.
Du spectacle
À ce stade, quelques mots sont peut-être nécessaires pour décrire, non seulement le spectacle, mais également les raisons pour lesquelles je n’ai cessé de m’y sentir étranger à divers points de vue. Chant’Oulipo est un spectacle imaginé, co-écrit, réalisé, financé et vaillamment promu par la comédienne et chanteuse Jehanne Carillon (que l’on peut notamment entendre, à l’occasion, dans l’émission radiophonique Des Papous dans la tête). Si Jehanne s’est entourée de personnes de grand talent pour le mener à bien (je pense en particulier au metteur en scène Laurent Gutmann), son projet n’en porte pas moins l’empreinte de sa personnalité et de ses goûts artistiques, jusque dans les moindres aspects : choix des textes, structure du spectacle, scénographie, orientation esthétique, et même arrangements et direction musicale — ce dernier point étant évidemment celui qui m’affecte le plus personnellement.
Combinant des éléments théâtraux et chantés, le spectacle fait signe vers l’héritage du music-hall, du cabaret (les numéros dansés en moins) ou, plus spécifiquement, des « variétés » telles qu’on les entendait au milieu du XXe siècle. Dire qu’il s’agit de musique « de variété » n’est donc pas ici à prendre dans un sens péjoratif : chaque numéro musical fait signe vers un langage pré-existant et clairement identifié (quoique parfois insensiblement subverti par l’usage de contraintes d’écriture).
Comme l’on peut s’y attendre, le spectacle est marqué par un attachement profond à l’Oulipo et à son environnement socio-culturel : j’entends par là non seulement ses auteurs actuels (dont les écrits ne sont malheureusement pas toujours, selon moi, à la hauteur de leur réputation), mais aussi son public relativement circonscrit sociologiquement — comme le trahissent quelques références culturelles convoquées par le spectacle : évocation de rues parisiennes, jeux de mots liés à la musique savante, allusion (longuement filée) à un film de Jean-Luc Godard,...
Une démarche (gentiment) expérimentale est parfois décelable dans certains passages, même si, auto-référence oblige, l’accent est mis davantage sur les contraintes liées au texte qu’à la musique (celles-là étant pourtant plus rares et moins originales que celles-ci). L’inventivité (et, sans doute, la drôlerie) réside en large partie dans l’aspect visuel du spectacle, qui met en scène des personnages d’un mauvais goût assumé (une forme de comique, latente et ambivalente, peut d’ailleurs naître du décalage entre la sociologie du public-type, que j’évoquais ci-dessus, et le milieu social évoqué sur scène par les décors et costumes oscillant entre cheap et clinquant), et détourne des objets du quotidien (ustensiles culinaires, pot de fleur, table à repasser).
Ultime justification du terme de « variété », la structure du spectacle (qui reflète son processus d’élaboration). J’ai tendance à distinguer (de façon primaire, pour d’aucuns) deux sortes de spectacles théâtraux : les spectacles écrits, et les montages. C’est clairement à cette seconde catégorie qu’appartient le projet en question, qui a commencé sous forme d’agrégat de textes mis (ou non) en musique et n’a jamais été le produit d’une écriture a priori ; c’est au contraire a posteriori (voire in extremis, puisque nous sommes dans les expressions latines) que mon collègue Olivier Salon a écrit quelques dialogues et scènes de transition, et que le metteur en scène Laurent Gutmann est parvenu à donner à l’ensemble une sorte de cohérence (en particulier visuelle, avec l’aide de Jean-Yves Courcoux et d’Axel Aust, respectivement créateurs des lumières et des costumes). Évidemment, je me sens plus familier d’une démarche de création où tout est écrit, ordonné et structuré à l’avance (quitte à trouver ensuite quelques améliorations surprenantes en cours de route) que dans un projet d’« élaboration collective » (collective mais non égalitaire, je l’évoquais plus haut) qui, à mon sens, ressemble davantage au désordre et au désœuvrement. Sans doute n’est-ce là qu’un reflet de ma personnalité psychorigide — du reste, je ne pense pas que le résultat reflète (grand merci) le sentiment de désordre qui a présidé, en ce qui me concerne, à son édification.
Des « droits »
Ma principale réticence à l’égard de ce spectacle, pour autant, n’est pas d’ordre esthétique, mais éthique : alors que j’ai toujours eu pour principe de publier mes travaux sous licence libre, mon implication dans ce projet revient à cautionner des travaux culturels sous le régime (abusivement appelé « droit d’auteur ») du « tous droits réservés », que je considère incompatible avec le fonctionnement sain d’une société éclairée et démocratique.
En effet — et ce n’est pas là la moindre de ses incohérences — les auteurs de l’Oulipo, ce creuset d’inventivité irrévérencieuse et subversive, publient insouciamment tous leurs écrits sous un régime « tous droits réservés » archi-protégé, verrouillé, jalousement gardé — en général par des éditeurs-industriels aussi notoires qu’ignominieux. Ces auteurs de génie qui ont tant fait pour montrer que le patrimoine littéraire est un gigantesque terrain de jeu où tout peut être revisité et réinventé, de « prothèse littéraire » en « plagiat par anticipation », ont à l’égard de leur propre production une tache aveugle monumentale : bien mal en prendrait à quiconque s’amuserait à transformer leurs livres comme, par exemple, le faisait Georges Perec en réécrivant la Brise marine de Mallarmé (qui n’était alors pas encore entré dans le domaine public).
Simple ignorance de leur part ? Voire. Il suffirait alors de parler avec les Oulipiens actuels pour obtenir d’eux (nonobstant les cors et cris de leurs éditeurs, sociétés de gestion collective et autres chœurs des pleureuses) l’autorisation de faire usage de quelques-uns de leurs écrits dans des œuvres diffusées de façon plus permissive ; ce projet de spectacle en était précisément l’occasion rêvée.
Las : il s’avéra très tôt qu’aucune remise en question de cet ordre ne serait envisagée par mes coéquipiers ; les œuvres concernées resteraient sagement dans l’escarcelle des sociétés de gestion collective, et la compagnie de théâtre s’acquitterait bien sagement du pizzo ponctionné sur les recettes de chaque représentation (environ 12% du montant récolté), censément en vue de « rémunérer les auteurs »... Alors même que les quatre cinquièmes des numéros musicaux sont mis en musique (par moi-même ou mon collègue Mike Solomon) hors de toute société de perception, et de façon purement bénévole. Non seulement c’est injuste (quoique de façon très relative, dans la mesure où je ne saurais prétendre qu’écrire de la musique de variété représente pour moi un effort intense et prolongé), mais c’est surtout une défaite absolue de mon engagement militant, par lequel je tiens à prouver qu’il est plus avantageux (et plus justifiable éthiquement) d’être payé a priori, au moyen d’une commande, qu’a posteriori par je ne sais quel pourcentage, royalty ou autre stock-option.
Quelques mots à ce sujet : il est de bon ton, dans beaucoup de compagnies théâtrales, d’évacuer la question de la rémunération des contributeurs au moyen d’un vague « tu seras payé en droits d’auteur » — autant dire, les calendes grecques. N’importe quel musicien devrait, à mon sens, s’insurger contre cette pratique, non seulement en ce qu’elle revient à le prendre pour une truffe, mais aussi en ce qu’elle nie la valeur même de son labeur : eh oui, inventer de la musique, cela demande du temps et du travail. L’on trouve tout à fait normal d’investir (souvent à perte) dans un décor, dans des techniciens ou dans la location d’une salle (j’y reviens) : en quel nom devrait-il en être autrement pour les travaux immatériels et intellectuels ?
Dans le cas d’un auteur non-inféodé aux sociétés de gestion collective, ce faux-semblant est soudain inopérant — et c’est là que tombent les masques : non, bien sûr, il n’a jamais été question de payer les musiciens ou les auteurs. En aucune façon. En ce qui concerne le projet Chant’Oulipo, j’ai même suggéré que me soit passée une commande d’un montant purement symbolique : il n’en a pas été question. (Seule compensation qui me fut offerte, et que j’aurais mauvaise grâce à ne pas apprécier : le privilège et l’honneur d’être moi-même présent sur scène.)
Des sous
Ma défaite actée et entérinée, je m’engageai donc dans les travaux de construction du spectacle (dont nous avons vu qu’ils furent laborieux et démesurément longs : d’abord de janvier à mars 2012 sous forme de tour de chant, puis de septembre 2012 à mars 2013 pour le spectacle à proprement parler), puis dans les représentations en province et à Paris.
Hormis quelques représentations dûment commandées et achetées (par des théâtres subventionnés), nous étions payés « à la recette », c’est-à-dire en fonction du montant payé par l’ensemble des spectateurs à la billetterie — ce qui encourage bien sûr à vendre les entrées au prix le plus élevé possible. (Sans tenir compte, hélas, des invitations — d’ailleurs accordées bien plus généreusement aux « programmateurs » hypothétiques qu’aux connaissances plus ou moins proches des interprètes. Mais à part ça, l’Art crée du lien social.)
Sur ce montant, une part (proportionnelle ou fixe, d’environ 400€ dans notre cas) va aux tenanciers du lieu et couvre, le cas échéant des frais annexes : rémunération du régisseur local, de la personne chargée de la billetterie (lorsqu’il y en a une, ce qui n’était pas le cas ici) ; 12%, nous l’avons vu, sont destinés aux sociétés de gestions collectives (et, très lointainement et indirectement, à quelques-uns des « auteurs » du spectacle, de façon parfaitement arbitraire) ; le reste est vaguement destiné à payer les personnes présentes sur scène, ou plus souvent à éponger les dettes contractées par la compagnie lors de l’achat du décor et des costumes, des représentations à pertes, des supports promotionnels imprimés et vidéo, et ainsi de suite — j’ignore, pour n’avoir jamais osé le demander, combien de milliers d’euros ont été perdus par Jehanne Carillon dans ce projet ; je dois reconnaître qu’elle n’a jamais paru le regretter. En fin de compte, nous avons joué bénévolement (ou pour une rémunération parfaitement symbolique) la très grande majorité du temps.
Ces conditions peuvent paraître drastiques ; elles reflètent pourtant la condition d’artiste de scène en France aujourd’hui, quoi que vous puissiez lire ou entendre. Le fameux « régime des intermittents », ce privilège si décrié ? Voici la réalité : sur une quarantaine de représentations, mes collègues ont eu moins d’une dizaine de cachets déclarés (dont seulement deux ou trois sur notre dernière série de 25 représentations). Du reste, le seul moyen d’avoir « ses heures » pour la plupart des intermittents aujourd’hui, est d’aligner des heures de cours ou d’ateliers, de redécouper des séries de représentations afin d’en faire des cachets isolés, etc. Le reste du temps est consacré aux démarches de « demandeur d’emploi » et autres procédures délibérément humiliantes d’« insertion dans la société ». J’ajouterai ici que je ne suis pas intermittent du spectacle et n’ai aucune intention de l’être ; je ne monte sur scène que par goût, par loisir et pour ma propre évolution artistique (c’est un grand mot), et ai renoncé depuis longtemps à survivre de mes activités scéniques ou scripturales.
Des conditions
Toujours histoire de remettre certaines pendules à l’heure, l’on me permettra de passer une deuxième couche de réalisme social. Comme la plupart des théâtres privés, le lieu dans lequel nous nous produisions accueillait deux ou trois (voire quatre le week-end) spectacles par soir ; une seule pièce permettait aux uns et aux autres de se changer et de ranger leurs décors à toute allure, le hall et les toilettes étant partagés avec le public (ou plus exactement les publics, ceux qui sortent et ceux qui font la queue).
Me chargeant en général de la corvée de vaisselle, il n’était pas rare que je sorte vingt minutes après le départ de mes coéquipiers (que je ne croisais plus, n’ayant guère de goût pour aller boire un canon ou manger un couscous au bar du coin). De telles conditions, s’ajoutant à des désaccords artistiques jamais résolus, n’aident guère à garder des rapports détendus et cordiaux ; pas question, notamment, d’aller à la rencontre du public après les représentations plutôt que d’aider les camarades à démonter le décor (sous peine de se faire tancer par lesdits camarades). Je ne parle pas ici d’un penchant narcissique pour les bains de foule, mais d’une curiosité naturelle, voire d’une simple précaution (le hall et ce que j’y entreposai, piles de partitions et tirelire, étant laissés sans surveillance en l’absence de réceptionniste).
Mais, c’est bien connu, l’Art crée du lien social.
Des captations
Lors de la reprise du spectacle début 2015, je fus frappé du fait que le régisseur de la salle avait pour habitude (pour consigne ?) d’annoncer avant chaque représentation, face au public, que les enregistrements du spectacle étaient interdits.
Cette disposition m’inspire des sentiments ambivalents : certes, tout artiste de scène est sujet à « des jours sans » et peut légitimement craindre de se retrouver un jour piégé, figé par la captation des pitoyables aléas d’une représentation particulièrement ratées, et donné ainsi en pâture au monde entier (ou tout au moins à la meute des commentateurs de YouTube). Même sans préjuger de la qualité du jeu de l’interprète, les conditions même d’un enregistrement médiocre sont de nature à desservir épouvantablement ce qui y est présenté. Il existe cependant un remède simple, même s’il requiert un investissement modique : mettez vous-même en ligne une captation vidéo que vous estimerez d’une qualité passable (que vous l’estampillez ou non comme officielle, et quels que soient ses moyens de production), et le public s’y réfèrera naturellement. Les seules situations où pourrait se propager une vidéo artisanale sont celles où il n’existe aucune source meilleure accessible librement... et celles, éventuellement, où ce qui est représenté est suffisamment marquant pour émouvoir (ou amuser) au-delà d’un simple cercle d’amis. Si tel est le cas, assumez votre talent (ou votre ridicule) : après tout, c’est vous qui avez fait le choix de vous présenter devant un public en premier lieu.
Ce dernier point mérite d’être souligné : en notre période où n’importe qui est à même de filmer n’importe qui, la question du soi-disant « droit à l’image » prête à tous les excès — y compris dans le sens de la répression hystérique et des paniques morales. La totale méconnaissance du public pour les aspects juridiques de la question n’a d’égal que son mépris pour la moindre décence, sans même parler d’éthique — je ne saurais compter les fois où des élèves ou leurs parents filment mes cours sans se soucier le moins du monde de ce que cela implique. Or quelqu’un qui fait le choix de prendre la parole dans un cadre public, sinon même de devenir un personnage public à part entière, ne saurait à mon sens prétendre à aucune légitimité pour interdire à ses contemporains de diffuser son image. C’est pour moi un non-débat.
Méconnaissance juridique et panique morale se rejoignent également, bien sûr, dans tout ce qui concerne la (très mal nommée) « propriété littéraire et artistique ». Outre les questions de narcissisme déguisées en « droit à l’image », la reproductibilité (du reste très imparfaite lorsqu’il s’agit d’une représentation scénique) des œuvres d’art se voit assimilée à du parasitisme commercial et du délit de contrefaçon. Le régime du soi-disant droit d’auteur règne par la terreur, et met à bas, tranquillement, quelques piliers d’une société démocratique saine et digne de ce nom ; il ne s’agit même pas, en l’occurrence, d’une « culture de la permission » mais tout simplement d’une culture de l’interdit : je ne laisse pas d’être surpris qu’aucun spectateur ne s’offusque de se voir accueillir dans un théâtre (ayant dûment payé sa place ou non, ce n’est même pas la question) par une liste de consignes plus ou moins arbitraires. Il ne s’agit même pas de rappeler des règles de savoir-vivre telles que de ne pas faire de bruit (ce qui en soi est déjà infantilisant, quoique malheureusement nécessaire), mais d’édits autoritaires dépourvus du moindre fondement éthique ou légal. (La même remarque pourrait s’appliquer à l’interdiction de prendre des photos dans les musées, dont tout aussi peu de citoyens semblent s’étonner.)
Mon premier geste fut donc, sous le regard narquois de mes collègues, de rédiger à l’intention du régisseur, une nouvelle annonce : « Dans un souci de civilité, nous vous prions de ne pas enregistrer cette représentation sans y être autorisé(e) par les interprètes. » Cette formulation me semble reformuler la chose sous un angle bien moins gênant, tant juridiquement qu’éthiquement. Elle prend évidemment une signification accrue lorsqu’il s’agit d’un spectacle mêlant des composantes Libres et non-Libres : en effet, interdire purement et simplement la captation (reproduction, diffusion) d’une œuvre publiée sous licence Libre, constitue une violation de sa licence — en d’autres termes, c’est un délit de contrefaçon.
De l’expérience
Du reste, nous étions déjà en pleine violation de licence à plus d’un titre : la plus élémentaire des clauses, partagée par à peu près par toutes les licences, est de mentionner, à chaque utilisation ou présentation de l’œuvre, le nom de la licence elle-même, afin que le public puisse s’y référer. Certaines licences sont davantage contraignantes : la GNU FDL, notoirement, requiert que l’on adjoigne le texte intégral de la licence à toute copie de l’œuvre (c’est du plus bel effet dans les rapports administratifs). Il y a une petite dizaine d’années, alors que j’envisageais de publier mon premier opéra sous licence , Richard Stallman m’avait suggéré que les ouvreuses (voire, les chanteurs eux-même) se baladent dans le public avant les représentations avec des paniers remplis de CD-roms, mis à disposition des spectateurs qui souhaiteraient consulter le code source de l’œuvre et le texte de la licence...
C’est en repensant à cette anecdote que j’annonçai à mes collègues (sans vraiment leur en demander la permission, ce dont il me fut peut-être tenu rigueur) mon intention, à titre expérimental, de tenir à disposition du public, à la sortie de chaque représentation, quelques exemplaires imprimés des chansons écrites par moi pour le spectacle. Dorénavant, outre l’annonce du régisseur les précédant, j’allais m’adresser au public à l’issue de chaque représentation pour dire : « Beaucoup de chansons que vous avez entendues ce soir sont mises en musique sous licence Libre, ce qui signifie que vous pouvez en consulter la partition, la copier, la jouer, la réinventer ; ces partitions sont disponibles sur le Web, mais il s’en trouve également quelques exemplaires à la sortie de cette salle, à votre disposition pour la somme de... votre choix ; je vous propose juste de ne pas descendre en-dessous de zéro euros. »
Et de fait, à la sortie de la salle (le plus souvent laissée sans surveillance, puisque nous n’avions pas d’ouvreuse dans ce théâtre), se trouvaient une petite pile d’exemplaires imprimés (d’une cinquantaine de pages), flanqués d’un papier indiquant le nom de la licence (Art Libre en l’occurrence) et ses conditions les plus marquantes, et une petite boîte ou urne (ou tronc ?) destinée à recueillir les éventuels dons des spectateurs.
Évidemment, comme dans toute forme artistique composite et polygraphe (où s’entremêlent, en l’occurrence, texte et musiques), le statut juridique du résultat « final » est sujet à question, particulièrement lorsque s’ajoutent ou se retranchent des régimes incompatibles. Les textes, nous l’avons vu, ne sont ni de moi ni publiés sous licence Libre ; ils figurent dans le spectacle au moyen d’une autorisation (grassement) payée à une société de gestion collective, qui se substitue aux auteurs pour accorder ou non des autorisations d’exploitation. (Cette même société ne voit aucun inconvénient, nous l’avons évoqué, à réclamer la même somme que le spectacle soit entièrement écrit par un de ses sociétaire ou soit presque entièrement mis en musique en-dehors de ses griffes — mais c’est un autre problème.)
Je reproduis ici la notice de copyright du recueil :
Textes d’origine : Jacques Roubaud, François Caradec, Olivier Salon, Hervé Le Tellier, Frédéric Forte, Paul Fournel, Jacques Jouet, et Ian Monk. Ces textes ont été réunis ou rédigés dans le cadre du spectacle "Chant’Oulipo" (http://chantoulipo.net) sur une idée de Jehanne Carillon et dans une mise en scène de Laurent Gutmann. Ils sont ici mis en musique et utilisés avec l’aimable autorisation de leurs auteurs, tous membres de l’Oulipo (http://oulipo.net). Les "Sardinosaures & compagnie" sont un recueil de Jacques Roubaud et Olivier Salon, publié en 2008 aux éditions Les mille univers. Mise en musique :" Copyright & copyleft © Valentin Villenave, 2012 pour la mise en musique. Les chansons « Début » et « Quand je pense » sont mises en musique par Mike Solomon (http://mikesolomon.org), de l’Oumupo. Les textes contenus dans cette partition restent propriété de leurs auteurs, pour lesquels tous droits demeurent réservés. La musique est en revanche publiée suivant les termes de la licence Art Libre (http://artlibre.org). Vous pouvez la copier, la modifier et la jouer librement sans contrevenir au droit d’auteur, à condition de respecter les termes de la licence (notamment en veillant à mentionner le nom des auteurs et adresses web d’origine). Pour obtenir une partition entièrement sous licence Libre, veuillez recompiler la partition avec l’option 'untainted, ce qui aura pour effet de remplacer tous les mots du texte d’origine par des syllabes aléatoires (par défaut «pa», «ta» et «touille»). La partition ainsi produite pourra être diffusée librement, sans autres restrictions que celles indiquées par sa licence.
Pour tenter de récapituler la situation juridique dans laquelle je me place :
- je ne crois pas contrevenir au droit moral des auteurs, puisque j’indique très clairement l’attribution et le régime juridique des textes (voir ci-dessous).
- s’il en a fourni la motivation originelle, le texte n’est pas indispensable à la partition ; pour preuve, je suis en mesure de distribuer aisément la même partition en remplaçant toutes les paroles par du pseudo-texte (c’est d’ailleurs ce que j’aurais fait si l’un des auteurs m’avait interdit de reproduire ses textes : zou, on met du « pa ta touille » à la place et ce sera tout aussi intéressant).
- il me semble pouvoir me prévaloir de l’autorisation explicite des auteurs, ce spectacle ayant été monté avec leur approbation (ils y ont assisté pour la plupart), autorisation dont j’ai même demandé moi-même confirmation en les contactant directement lorsque j’ai publié la partition de ces chansons.
- en droit français, l’auteur est entièrement souverain — ce qu’oublient volontiers les sociétés de gestion collective. Une autorisation directe de l’auteur peut peut-être mettre ce dernier en difficulté vis-à-vis des termes contractuels le liant à son éditeur ou à sa société de gestion collective, mais dans ce cas notons que a) c’est leur problème, pas le mien ; b) violer un contrat n’est pas violer la loi c) il pourrait être argué (je suis prêt à le faire) de ce que les termes en question sont de toute façon abusifs et devraient être réputés non avenus.
- enfin, ma démarche constitue-t-elle une exploitation commerciale ? Ce point mérite d’être discuté plus en détail.
Du commerce ?
La définition juridique d’un acte commercial, en droit français, est indissociable de l’activité (habituelle, voire professionnelle) d’un commerçant. Il n’y a donc pas, en l’espèce, d’acte de commerce à proprement parler, et le stock de partitions que j’ai fait imprimer (j’y reviens) ne constitue pas un fonds de commerce.
Mais allons plus loin : l’argent recueilli au cours de cette opération, que signifie-t-il ? S’agit-il de vente, ou de don ?
À strictement parler, il s’agit effectivement de vente puisque dans la façon dont je le présente au public, le bien est obtenu par le public en contrepartie d’un paiement — paiement pouvant être d’un montant nul ou purement symbolique. Mais précisément, le fait que ce paiement soit d’un montant non fixé (en tout cas, non fixé a priori et non déterminé par le vendeur) et potentiellement nul, montre que l’accès au bien n’est en fait pas subordonné à une transaction numéraire — critère qui me semble constitutif de la vente. Qu’en est-il ? Je laisserai à de véritables juristes le soin de trancher.
Très curieusement, les personnes à qui j’ai fait part de ce questionnement ont invariablement réagi par une hostilité narquoise, me soupçonnant de couper les cheveux en quatre en toute mauvaise foi pour faire oublier la motivation perfidement mercantile de l’opération. Il n’en est rien — et le fait même que j’aie pris soin, contrairement à ce que d’aucuns me conseillaient (parfois les mêmes, allez comprendre), de ne pas exiger du public un montant minimum, devrait suffire à attester de ma bonne foi.
Le succès inattendu (quoique très relatif, comme nous le verrons) de cette initiative, ne fut pas sans susciter quelques haussements de sourcil parmi mes collègues — particulièrement lorsque les « ventes » de partitions s’avérèrent dégager davantage de bénéfices que la billetterie, nettement déficitaire en regard des frais exigés par le tenancier de la salle. Dans une volonté, là encore, de prouver que ma démarche n’était pas sous-tendue de vénalité égoïste, j’offris d’aider à combler les dettes de la compagnie — dans l’hypothèse où je dégagerais un bénéfice notable. Je n’aurais pas été disposé, en revanche, à verser une part aux auteurs des textes mis en musique — moins parce que je m’oppose, par principe, aux rentes et autres droits « de suite », que par volonté de ré-équilibrer le rapport de forces socio-économique : nous nous trouvons dans un système qui fait tout pour encourager les auteurs à s’assujettir aux sociétés de gestion collective et laisse les autres dans le dénuement le plus ostensible ; me retrouvant (bien malgré moi) dans la seconde de ces deux catégories, je n’ai pas la moindre envie de porter assistance aux idiots utiles du « camp » d’en face, béatement lovés qu’ils sont dans leur cocon (pensent-ils) protecteur.
En effet, ne nous y méprenons pas : si je l’expose de la façon la plus rationnelle et impartiale qui me soit possible, ma démarche n’en est pas moins un acte militant. C’est pourquoi il aurait été inconcevable pour moi de supprimer entièrement l’aspect monétaire de l’expérience, en me comptant d’offrir les partitions sans contrepartie (encore que je m’y retrouvai parfois poussé, nous le verrons). Le but de l’expérience était précisément d’établir la viabilité, y compris financière, d’un modèle alternatif de distribution artistique.
Ce modèle, d’ailleurs, n’a plus rien de nouveau aujourd’hui : depuis une décennie, le modèle « pay what you want » s’est largement répandu sur le Web, au point de devenir une tarte-à-la-crème des campagnes de diffusion branchouilles-2.0-contributives-truc2. C’est précisément de là que germe l’objection qui lui est généralement adressée : on sait que ce modèle fonctionne très bien lorsqu’il s’adresse à une clientèle déjà constituée, formant un groupe sociologique assez uniforme (CSP+ tertiarisées, classes moyennes supérieures urbaines blanches) mû par des dynamiques communautaires — en d’autres termes, une fanbase. Mon propos était donc de montrer l’applicabilité (ou non) de ces schémas dans un cadre matériel, et auprès d’un public (en partie) sociologiquement différent.
Quoi qu’il en soit (et comme l’illustrent les quelques chiffres que je fournirai ci-dessous), l’expérience telle que je l’ai menée est restée confinée dans une « micro-économie informelle ». La faible envergure des bénéfices dégagés (mais n’anticipons pas) a suffi à calmer les éventuelles aigreurs ayant pu accompagner mon initiative... et je dois avouer ne pas avoir éprouvé le besoin de déclarer à l’administration fiscale cette source de revenus — du reste parfaitement négligeable. Moins par volonté de dissimulation que par simple flemme ; je ne ferais sans doute pas un bon blanchisseur.
Des chiffres
Voici maintenant quelques données précises, recueillies au long de l’expérience. Commençons par le coût de fabrication des exemplaires — lequel n’inclue pas le temps que j’ai consacré à écrire, puis éditer et ré-arranger les chansons, ainsi qu’à les accompagner de quelques commentaires. Le document fut imprimé dans un copy-shop de mon quartier, avec une couverture en « couleur » suivie d’une cinquantaines de pages format A4 recto-verso, ainsi qu’une reliure en plastique bon marché (quoique relativement atroce).
Dans mon à peu près certitude que la musique écrite n’intéresserait pas grand monde (divergeant en cela de mes acolytes, pour qui il ne faisait aucun doute qu’elle n’intéresserait absolument personne), je commençai par faire imprimer six exemplaires ; puis quelques jours plus tard, me ravisant, j’allai jusqu’à vingt (ce serait largement suffisant, me dis-je, pour un mois et demi de représentations). Finalement, je revins encore dans la petite boutique pour en imprimer plusieurs dizaines supplémentaires, allant jusqu’à un total de 130 exemplaires. Après avoir déboursé sept euros par exemplaire, le prix descendit au-dessous de cinq.
| Exemplaires | Coût par exemplaire | Coût global |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 42 |
| 14 | 6 | 84 |
| 30 | 4.7 | 141 |
| 50 | 4.65 | 232.5 |
| 30 | 4.7 | 141 |
| Total : 130 | 640.5 | |
La somme recueillie n’est pas toujours corrélée avec le nombre d’exemplaires emportés :
||Revenus||
|Date|Exemplaires|Somme recueillie|
|08 janvier|1|20|
|09 janvier|2|30|
|11 janvier|1|20|
|15 janvier|2|25|
|16 janvier|1|5|
|17 janvier|3|45|
|18 janvier|6|4|
|22 janvier|3|34.2|
|23 janvier|8|35|
|24 janvier|4|37|
|25 janvier|11|59.13|
|29 janvier|4|23|
|30 janvier|2|12.2|
|31 janvier|2|8|
|01 février|4|21.2|
|05 février|1|5|
|06 février|1|9|
|07 février|7|49|
|08 février|5|6.4|
|12 février|7|50.9|
|13 février|8|67|
|14 février|12|59|
|15 février|7|36|
|Total : 102|<|661.03|
Pour>
article238]) et augmenta de façon visible quoiqu’irrégulière (la dernière semaine, si mes souvenirs sont bons, allait de 80 spectateurs à... moins de 20).
Enfin, une dernière série de chiffres doit être prise en compte : les exemplaires que j’ai moi-même offerts gracieusement (comme on dit) lors de rencontres fortuites en coulisses. À tel de mes coéquipiers, à la fille d’un autre acolyte ou d’un commanditaire, à deux spectateurs anonymes et à des élèves d’école primaire. Aux sept ou huit exemplaires que distribuai ainsi, s’en ajoutèrent vingt que j’apportai lors d’une représentation à l’Opéra de Clermont-Ferrand. Mes collègues m’avaient invité à ne pas solliciter de dons lors de cette représentation, de crainte que cela ne revienne à détourner une structure à vocation publique dans un but commercial privé ; je ne suis pas insensible à cet argument mais il faudrait alors s’interroger sur la légitimité qu’il y a à faire payer les spectateurs... et, puisqu’on parle de détournement, à consacrer une partie des recettes à arroser des sociétés privées de gestion collective (sous prétexte de « rémunérer les auteurs »). Par altruisme autant que par bravade, je choisis donc de descendre dans le hall et de remettre mes exemplaires à qui en voudrait bien — naturellement, il ne fallut pas cinq minutes pour que la vingtaine de copies en ma possession disparaisse, notamment au profit d’une horde de lycéens qui avaient passé la première moitié du spectacle penché sur des écrans d’iPhones, et la deuxième moitié debout sur les sièges pour applaudir.
Des conclusions
Les données regroupées ici, particulièrement si on les rapporte aux estimations de fréquentation, mettent en évidence une diminution progressive du montant moyen par exemplaire, en rapport inverse avec l’augmentation du succès : l’hypothèse que je propose (outre la possibilité, avérée quoique marginale, que plusieurs spectateurs soient revenus voir le spectacle et n’aient donc plus besoin de partition) est qu’au fil des représentations nous avons attiré un public plus large mais de ce fait moins investi à titre personnel.
Les données font également apparaître quelques aberrations : le dimanche 18 janvier où quelqu’un a manifestement tapé dans la caisse (en l’absence, encore une fois, de toute surveillance), ainsi que le 8 février où quelqu’un s’est, selon toute vraisemblance, saisi de plusieurs exemplaires sans contrepartie.
D’autres facteurs, moins prévisibles, ont joué un rôle observable : ainsi, lorsque je remplaçai la petite boîte en faïence ouverte à tous les vents par une urne opaque (confectionnée par ma femme), le montant donné par les gens a accusé une nette diminution... Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de constater que lorsque je me trouvais moi-même derrière la pile de partition (davantage, comme nous l’avons vu, dans un souci de surveillance que pour serrer les paluches), les partitions (et le don) suscitaient un intérêt nettement moindre. Je ne saurais guère expliquer ce phénomène, mais je me demande si une corrélation analogue (ou plus probablement, inverse) serait observable si j’avais laissé à quelqu’un d’autre que moi le soin d’annoncer, à la suite des représentations, la possibilité de consulter et emporter les partitions.
Compte tenu de ces aléas (et des exemplaires que j’ai offerts en-dehors de tout dispositif d’incitation au don), le « bénéfice » dégagé s’élève à... 20 euros et 53 centimes. Si j’en excluais les exemplaires offerts et les actes de malveillance ayant pu affecter l’expérience, la balance totale atteindrait probablement 300 voire 400 euros. Pour peu que j’aie fait imprimer les exemplaires d’un seul bloc en premier lieu (ou que je sois parvenu à réduire le coût de fabrication d’une manière ou d’une autre), il n’aurait pas été difficile d’obtenir 100 ou 150 euros de plus (du reste, je doute que beaucoup de gens aient imaginé que le coût de fabrication de l’objet pouvait être aussi élevé). Dans cette hypothèse la plus haute, il n’est pas difficile, alors, de réaliser que la somme recueillie auprès du public sans la moindre contrainte dépasserait largement celle qu’aurait légalement pu extorquer n’importe quelle société privée de soi-disant « droits d’auteur », et qu’auraient alors hypothétiquement pu recevoir (sous réserve d’un délai d’attente, d’un calcul de répartition au doigt mouillé et autres alchimies arbitraires) lesdits auteurs.
Notons, de surcroît, que cette expérience ne s’est pas substituée au système traditionnel ; elle s’y est ajoutée, et subit ainsi le handicap dont est affligé tout le milieu des licences Libres : au lieu de construire un monde moins contraignant comme nous y invitent nos idéaux, nous ne faisons souvent que superposer nos propres contraintes à celles, iniques, que disposent les lois. En l’occurrence, les spectateurs qui ont généreusement offert 15 ou 20 euros en contrepartie d’un bien culturel auquel ils avaient de toute façon accès, avaient déjà dû débourser 18 euros pour assister au spectacle. La véritable expérience, celle qui reste à mener, aurait été de ne pas faire payer l’entrée, ou tout au moins d’en déduire la fraction soi-disant attribuée à la soi-disant rémunération des soi-disant « droits d’auteur » ; de ce point de vue, l’opération Chant’Oulipo restera une occasion manquée.
S’il n’est évidemment pas une martingale, le modèle de paiement/don purement volontaire (pay what you want) n’en finit plus de prouver sa viabilité économique — et pas seulement dans le domaine des biens culturels numérisés : tous les artistes de scène qui jouent « au chapeau », d’une certaine façon, mettent en œuvre ce mécanisme. Je n’entends pas par là que les dons permettent à un artiste de vivre ; j’affirme cependant qu’ils ne mettent pas ce dernier dans une position si inenviable, ni dans un degré de misère très supérieur à celui de ses confrères, obligés de payer l’immonde rentier qui daigne leur louer à prix d’or une salle minuscule, endettés auprès de leurs techniciens, saignés par les sociétés de droit d’auteur, et autres frais aussi illégitimes qu’incompressibles.
De surcroît, la création et la diffusion artistique ne se résument pas à une question de viabilité économique ; sans être illégitime, cette question ne sert depuis trop longtemps qu’à nourrir une propagande mensongère et moralisatrice au service de l’idéologie du capitalisme industriel. Puisqu’on nous bassine à longueur d’éditoriaux sur la « diversité » et sur le « lien social », comment se fait-il que les véritables implications sociales de l’art soient si couramment occultées ?
La citoyenneté ne se définit pas par la capacité à obéir et à consommer. Permettre à chaque spectateur de payer selon son goût, son envie, ses moyens et (oui) son égoïsme éventuel, c’est redéfinir entièrement le schéma contraignant et infantilisant sur lequel repose le capitalisme (« pas de bras, pas de chocolat »). C’est ouvrir au public un accès direct aux artistes et aux auteurs (supprimant ainsi les intermédiaires industriels et leurs nervis des sociétés de gestion collective) : l’art ne devient plus une transaction verticale entre producteur et consommateur mais un échange égalitaire et respectueux. C’est, enfin, s’adresser à l’intelligence de chaque individu, pour le meilleur et (ô combien) pour le pire plutôt que d’envisager le corps social dans une optique purement normative-répressive. Pari utopique ? Nul ne le saura tant que l’expérience n’en sera pas menée ; en ce qui concerne la très modeste tentative que j’ai conduite ici (modeste de par son envergure plutôt que ses ambitions, convenons-en), ses résultats me semblent plutôt encourageants.
Et puisqu’il est question d’intelligence du public, je voudrais terminer sur un dernier mot : depuis une quinzaine d’années que j’officie dans le milieu musical (et plus particulièrement dans l’enseignement musical spécialisé), m’ont été fournies maintes occasions de ressentir le rouleau compresseur de la culture industrielle de consommation, lequel voudrait nous faire croire que la musique écrite en général (et la musique contemporaine en particulier) est un objet du passé. L’intérêt suscité par ma petite expérience, quelle qu’en soit la petitesse, me redonne quelque espoir à ce sujet. Certes, il est possible qu’une partie du public ait vu en mes partitions de simples goodies (et j’aurais sans doute eu plus de succès avec des porte-clés) ; certes, il s’agit de variété plutôt que de musique savante ; certes, le fait que le recueil mêle des chansons plus ou moins accessibles, et que chaque morceau soit accompagné d’explications textuelles, en fait un objet à même d’intéresser jusqu’à des gens dépourvus de notions musicales.
Il n’empêche : je suis content et fier d’avoir vu, à cette occasion, tant de personnes différentes se saisir d’une partition, la parcourir comme un objet vaguement familier, l’examiner, s’interroger, la reposer ou finalement l’emporter (ne serait-ce que comme un souvenir ou un trophée).
La preuve est faite : la musique écrite, ça ne mord pas.
Même la mienne.
 [Le Site]
[Le Site]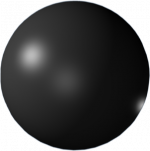 Les licences Libres au théâtre : compte-rendu d’une expérience sociale
Les licences Libres au théâtre : compte-rendu d’une expérience sociale